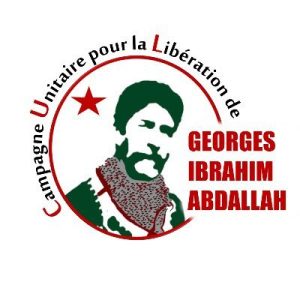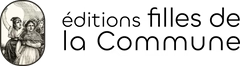Nous proposons une traduction non officielle d’un article paru sur Yeni Demokrasi le 25 septembre au sujet des révoltes au Népal.
Au cours des trente dernières années, le Népal a été le théâtre d’une des expériences les plus remarquables du mouvement révolutionnaire mondial. Ce petit pays montagneux, qui avait conservé son caractère semi-féodal et semi-colonial, s’est transformé en une source d’espoir pour les classes et les peuples opprimés du monde entier grâce au puissant développement de la guerre populaire lancée en 1996 et aux possibilités de pouvoir qu’elle a créées pour les opprimés. Cette source concrète d’espoir a été perdue lorsque la vague révolutionnaire, qui s’était étendue jusqu’aux environs de Katmandou, s’est rapidement retirée à mesure que la conception bourgeoise prévalait au sein du Parti Communiste, et lorsque la révolution a été abandonnée au profit d’un compromis avec la réaction népalaise, limité à « l’abolition de la monarchie ». La vague révolutionnaire, qui s’est rendue à la réaction bourgeoise, s’est inévitablement retirée, pour mieux reprendre de plus belle.
Aujourd’hui, le Népal est à nouveau à l’ordre du jour avec des développements stupéfiants. Des mouvements de rue reflétant la colère de la jeunesse, la dissolution des relations et le déséquilibre au sein du bloc au pouvoir, des gouvernements intérimaires, le mécontentement social et des forces cherchant à se faire une place dans tout ce tableau… Cependant, il n’est pas possible de saisir correctement la situation en se contentant d’observer les développements actuels. Il est nécessaire de se souvenir, de tirer les leçons et de discuter des accumulations, des acquis et des erreurs du passé. L’expérience révolutionnaire au Népal revêt une importance particulière pour enseigner à quel point il est vital de lutter, complètement et jusqu’au bout, contre le révisionnisme et toutes les formes de réaction ; de plus, cette expérience est récente.
La naissance de la guerre populaire, la marche vers le pouvoir et l’ancrage dans le parlementarisme
Au milieu des années 1990, la structure sociale du Népal présentait les caractéristiques classiques d’une société semi-coloniale et semi-féodale. Les paysans sans terre, les relations féodales, la discrimination ethnique et fondée sur les castes, l’oppression des femmes sous toutes les formes de patriarcat, mais surtout le patriarcat féodal, une économie fragile dépendante de l’impérialisme et la domination de la classe capitaliste bureaucratique : toutes ces conditions avaient amplifié la colère du peuple et rendu possible un débouché révolutionnaire.
La direction maoïste, avec la guerre populaire qu’elle a lancée en 1996, a mis en pratique la stratégie consistant à encercler les villes depuis les campagnes. Cette guerre, qui a duré dix ans, a conduit à la création de zones de base révolutionnaires dans 80 % du pays, à la croissance de l’Armée populaire de libération, qui est devenue une force comptant des centaines de milliers de membres, à la dissolution des autorités féodales et à la construction d’organes du pouvoir populaire. Au cours de cette période, le peuple népalais a saisi l’occasion de construire un ordre dans lequel les classes opprimées pouvaient respirer grâce à leurs propres organisations.
En 2006, la capitale, Katmandou, a été assiégée par l’Armée populaire. Le siège, qui a duré plusieurs mois, s’est transformé en une politique qui a ouvert la voie à la prise du pouvoir par le biais d’un « processus de paix ». Ce fut un tournant dans la trajectoire du mouvement maoïste. Au lieu de prendre le pouvoir par la lutte armée, les thèses de l’adhésion au système parlementaire, de la « démocratie multipartite » et de la « transition pacifique » ont été avancées, et la théorie de la « fusion » a été conclue par une conception de la « révolution » sans révolution. Cette ligne, promue par la direction de Prachanda et Bhattarai, soutenait que la révolution démocratique nouvelle pouvait être menée à bien par des processus parlementaires tout en préservant l’équilibre des pouvoirs créé par la guerre populaire. Le PCN(M) est parvenu à un compromis avec les représentants politiques de la bourgeoisie compradore-bureaucratique et a accepté le renversement de la monarchie. En échange de cet accord, la ligne de « coexistence pacifique et de lutte », qui visait à légaliser la lutte révolutionnaire dans le cadre de l’ordre existant, a été adoptée. Celle-ci a ensuite été défendue par l’argument fallacieux selon lequel la nature de l’ère de l’impérialisme et des révolutions prolétariennes avait subi un changement qualitatif. Ce sophisme, enveloppé dans les théories de la mondialisation qui discourent sur le changement de nature de l’impérialisme, prouvait que la perspective de classe avait été abandonnée. Un phénomène de classe abstrait de l’impérialisme a été créé, et la lutte révolutionnaire a été réduite à un simple outil de lutte de factions.
Cependant, le processus de paix a entraîné la liquidation des acquis révolutionnaires. L’Armée populaire de libération a été désarmée, les bases ont été démantelées, les terres occupées par les paysans ont été rendues aux propriétaires fonciers et l’organisation de jeunesse, qui avait obtenu des acquis importants dans la guerre et la lutte révolutionnaires, a été neutralisée. Le mouvement, qui avait autrefois pris clairement position contre l’impérialisme et l’expansionnisme indien, s’est orienté vers la recherche d’une harmonie avec ces puissances.
La « République démocratique », présentée comme une révision des théories les plus fondamentales du socialisme scientifique, n’éliminait pas les racines économiques et culturelles du féodalisme, même si elle mettait fin à la monarchie, représentante politique traditionnelle du féodalisme. En effet, malgré une forte représentation au parlement, le pouvoir réel restait entre les mains de la classe bureaucratique-compradore et des interventions impérialistes. Alors que les attentes des masses en matière de pouvoir étaient frustrées, la lutte « des deux lignes » au sein du parti est apparue au grand jour. D’un côté, il y avait la direction qui prônait la voie parlementaire, et de l’autre, l’opposition interne au Parti, qui avait accepté la déviation lorsqu’elle avait commencé, la défendant même avec ardeur, mais qui avait ensuite plaidé pour un retour à la ligne révolutionnaire.
Les conséquences des déviations idéologiques
L’aspect le plus critique de l’expérience népalaise réside dans les déviations qui se sont produites au niveau idéologique. Ces déviations, en tirant parti de l’espace qu’elles ont trouvé et en combinant avec le fait que l’histoire ne pardonne pas le vide, ont pris une forme révisionniste et, en dernière analyse, l’ont rendue réactionnaire. Des thèses telles que l’impérialisme prenant la forme d’un « État mondial » – déclarant ainsi l’impérialisme vainqueur absolu en rejetant l’idée que c’est le stade de pourrissement du capitalisme qui entraînera sa fin – que l’analyse de Lénine sur l’impérialisme était « insuffisante » et que les théories révolutionnaires de Mao ne sont « plus valables » aujourd’hui, ont trouvé leur place dans les documents officiels du mouvement. C’était l’expression théorique d’une orientation passant de la ligne révolutionnaire au révisionnisme.
Alors que l’essence de la révolution réside dans l’intensification de la lutte des classes et l’action organisée des masses populaires, la direction s’est progressivement confinée dans les limites de la collaboration de classe, du réformisme et de la démocratie bourgeoise. Ainsi, tous les acquis de la guerre populaire qui a duré dix ans ont été compromis et en grande partie perdus. Au lieu d’achever la révolution démocratique et de construire le socialisme, le PCN(M) a choisi la voie de l’interruption de la révolution démocratique et de la dégénérescence avec des critères bourgeois parlementaires qui servent le système impérialiste.
La dégénérescence et le déclin du CPN(M) se concrétisent par son incapacité à réaliser des progrès malgré son accession au pouvoir par la voie parlementaire. C’est pourquoi, bien que son leader Prachanda (Pushpa Kamal Dahal) ait occupé le poste de Premier ministre à trois reprises pendant de courtes périodes, de 2008 à 2009, de 2016 à 2017 et enfin de décembre 2022 à juillet 2024, le parti n’a pas pu atteindre son « succès » initial. À chaque fois, le « pouvoir » a été cédé aux réactionnaires. Le dernier Premier ministre en date, KP Oli, fait également partie de ces réactionnaires, bien que le nom de son parti comporte l’adjectif « marxiste-léniniste ». Le déclin du pouvoir n’a pas commencé avec le CPN(M), qui avait abandonné la ligne maoïste… Le Premier ministre qui a été contraint de fuir le pays après les derniers événements est le chef du Parti communiste népalais (marxiste-léniniste unifié). Ce parti et son chef ont, dès le début, continuellement organisé l’opposition contre le CPN (maoïste), qui se considérait comme maoïste mais s’était éloigné de la ligne maoïste de la manière que nous avons mentionnée ci-dessus.
La situation actuelle : rébellion des jeunes, violence et crise politique
Le Népal est à nouveau en proie à des troubles aujourd’hui. Les jeunes, en particulier ceux qui portent le lourd fardeau du chômage, de la corruption et d’un avenir incertain, sont descendus dans la rue pour participer à des manifestations de masse. Au cours de ces manifestations, auxquelles ont participé des dizaines de milliers de personnes, des dizaines ont été tuées et des centaines ont été blessées. Les appareils répressifs de l’État ont répondu au peuple par des balles et des gaz lacrymogènes.
Ce processus a non seulement conduit à une crise gouvernementale, mais il a également marqué une rupture avec des années de corruption, de modes de vie luxueux et de distractions parlementaires. La démission du Premier ministre Oli et la mise en place d’un gouvernement provisoire à sa place ont été le résultat de cette pression. La nomination de la juge Sushila Karki, choisie par les jeunes lors d’un vote sur Internet, au poste de Premier ministre provisoire est une nouveauté symbolique. Bien que Sushila Karki, également considérée comme la première femme Premier ministre et connue pour avoir mené des enquêtes sur la corruption et les pots-de-vin au sein des gouvernements, soit perçue comme une réponse « suffisante » à la rébellion actuelle, cela est loin d’être une véritable réponse aux revendications sociales.
Les revendications avancées par le mouvement de jeunesse, à savoir la fin de la corruption, une solution au chômage, la justice et la liberté, sont directement liées aux fondements de classe. Les larges masses paysannes sont toujours confrontées au problème foncier, à l’endettement et à la migration forcée. La classe ouvrière et les travailleurs luttent pour leur survie dans des conditions de travail précaires, avec des salaires bas et une dépendance à l’égard de la main-d’œuvre migrante. Les femmes, les Dalits, les minorités ethniques et les communautés religieuses, quant à elles, sont confrontées à la discrimination et à une oppression multiforme.
La rébellion des jeunes d’aujourd’hui s’inscrit également dans la lignée du mouvement maoïste d’il y a plusieurs années. La conscience, l’organisation et l’expérience de lutte issues de la guerre populaire sont encore présentes aujourd’hui dans la mémoire de la société népalaise. Cependant, cet héritage a été en grande partie bafoué lorsque les dirigeants se sont enlisés dans le parlementarisme au détriment de l’autonomisation des masses. La colère des jeunes est dirigée non seulement contre les gouvernements corrompus d’aujourd’hui, mais aussi contre ceux qui sont arrivés au pouvoir avec des revendications révolutionnaires et qui ont fini par s’intégrer dans le même système. À tel point que le déplacement des représentants de la décadence et de la corruption au Népal aujourd’hui par des actes de violence, mis en évidence par les gros titres comme des « lynchages » dans la presse bourgeoise-féodale, a également effrayé ceux qui marchaient autrefois avec les slogans populaires les plus virulents et se qualifiaient eux-mêmes de « communistes ». Les appels à la modération et aux appels non violents au Parlement pour trouver une solution lancés aux jeunes par Baburam Bhattarai, qui a été Premier ministre entre 2011 et 2013, l’un des leaders de la guerre populaire qui a débuté en 1996, qui s’est ensuite séparé du CPN(M) et a subi une transformation suffisante pour « découvrir la valeur de Trotsky », sont le fruit de cette peur.
Une fois encore, une forme d’organisation qui se dit indépendante et qui se distingue par des revendications plus révolutionnaires a également émergé au cours du processus. Le succès que ce comité, baptisé SAFAL, remportera dans la gestion et la poursuite du processus reste pour l’instant incertain. Son statut d’organisation de rue, son positionnement revendiquant la création d’un front ouvrier et son évolution doivent être examinés au cours du processus. Cependant, il est clair que les revendications fondamentales qu’ils ont exprimées tout au long des actions sont des revendications qui doivent être soutenues et amplifiées.
Pour cette raison, le mouvement qui se développe dans la rue montre un caractère indépendant des partis existants. Mais le manque d’organisation et de clarté idéologique doit être considéré comme un indicateur clair que le mouvement ne parviendra pas à réaliser des progrès sociaux.
Au Népal aujourd’hui, les paysans continuent d’exiger la résolution de leurs problèmes fonciers, la levée du fardeau de la dette et l’accès aux moyens de production. Cependant, le processus parlementaire a entraîné le renversement, et non la satisfaction, de ces revendications. (Rappelons qu’avec l’entrée de la révolution népalaise dans le processus de paix, la direction révisionniste avait depuis longtemps abandonné la révolution agraire, qui est l’essence même de la Révolution de Nouvelle Démocratie, et avait restitué les terres saisies pendant la guerre populaire aux vestiges du système pourri, c’est-à-dire aux anciens propriétaires, ennemis des paysans !)
Aujourd’hui, les millions de travailleurs népalais qui ont été contraints d’émigrer à l’étranger constituent l’épine dorsale de l’économie du pays, mais sont privés de leurs droits. Les travailleurs à l’intérieur du pays, quant à eux, vivent dans des conditions précaires, sans syndicat et avec de faibles salaires.
Les jeunes sont la force motrice du mouvement actuel. Le chômage et l’angoisse face à l’avenir les rendent à la fois furieux et ouverts à des revendications radicales.
L’avenir du mouvement actuel dépend de la réappropriation des leçons de la guerre populaire, mais avec une position de classe cohérente et profondément révolutionnaire. La grande erreur commise dans le passé doit être ancrée dans la conscience des masses afin qu’elles comprennent que la corruption actuelle est une orientation bourgeoise, le remplacement de la stratégie révolutionnaire par le parlementarisme. Il ne s’agit pas d’une erreur tactique, mais d’un résultat qui découle de déviations idéologiques, de la révision de la science du marxisme-léninisme-maoïsme. L’histoire et la science ont prouvé que la véritable libération des masses n’est pas possible en faisant des compromis avec les ennemis de classe, mais en brisant leur pouvoir.
L’insurrection nouvelle du peuple népalais peut prendre une direction révolutionnaire si elle s’accompagne d’une direction correcte, d’une ligne idéologique claire et d’une auto-organisation des masses. Sinon, les solutions réformistes, les gouvernements provisoires et les jeux électoraux absorberont la colère des masses sans résoudre les problèmes fondamentaux.
En conclusion
Le Népal, passé et présent, est une expérience concrète qui montre à la fois la force et les faiblesses du mouvement communiste international et des avant-gardes prolétariennes. La guerre populaire a prouvé ce qui peut être accompli grâce à la lutte organisée des classes opprimées. Mais le parlementarisme, dans lequel la déviation a trouvé son reflet, a fait dérailler la révolution. Si le mouvement populaire, qui renaît aujourd’hui sous la direction de la jeunesse, tire les leçons de cette expérience, il peut être le terreau d’un nouveau départ.
Le Népal conserve encore son caractère semi-féodal et semi-colonial ; l’impérialisme et les classes compradores continuent d’exploiter le pays. La libération des classes opprimées sera possible en récupérant les acquis du passé et en construisant l’avenir sur ces fondations. En ce sens, la réalité et la nécessité de la révolution de nouvelle démocratie comme étape de transition vers le socialisme dans ces pays demeurent.
Il est également nécessaire de dire un mot contre ceux qui utilisent le processus de révisionnisme des dirigeants de la révolution népalaise et leur ralliement à la classe adverse comme justification pour attaquer de manière méprisable le marxisme-léninisme-maoïsme. Les partisans du MLM, qui se prétendent les plus ardents défenseurs et leaders de la révolution prolétarienne mondiale, ont présenté leurs critiques tant lorsque la guerre populaire au Népal était à son apogée que lorsqu’elle était au plus bas, et ils ont mené une lutte idéologique à ce sujet. Le corpus de cette lutte idéologique suffirait à lui seul à épater cette coalition composée d’« hybrides » et d’un « amalgame de déchets » qui attaque aujourd’hui le MLM. Les maoïstes du monde entier savent qu’à l’ère de l’impérialisme et des révolutions prolétariennes, la cause de la Révolution de Nouvelle Démocratie, du socialisme et du communisme avancera avec des victoires et des défaites, et que ces expériences renforceront les luttes des révolutions prolétariennes. Ils savent, défendent et expliquent que le révolutionnarisme cohérent jusqu’au bout exige une lutte continue. La révolution prolétarienne mondiale n’est pas sans propriétaires. Remettre le processus dans lequel nous sommes sur la bonne voie est, malgré tout, possible et sera possible.