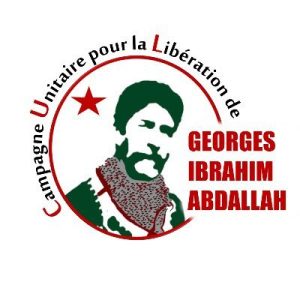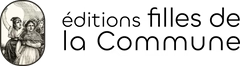Le 12 juillet, un texte largement qualifié dans la presse bourgeoise d’« historique » a été signé par les partis indépendantistes et loyalistes de Kanaky. Le FLNKS, représentant majeur des indépendantistes, se félicite de la création d’un « État calédonien » au sein même de l’État français. Pourtant, Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, annonce que « la Nouvelle-Calédonie restera française ». Que cache réellement cet accord ?
Après dix jours de négociations sous le patronage du gouvernement français au château de Bougival, près de Paris et à 17 000 km de Nouméa, les représentants des partis de Kanaky ont signé. Cet « accord » n’en est pas un et n’a pas de valeur juridique réelle tant qu’il n’est pas ratifié, et traduit en textes législatifs réels, mais il donne une idée de la stratégie de l’État français pour maintenir sa domination impérialiste sur un archipel en feu. Cet accord prévoit en effet une modification du statut de la Kanaky : le texte acte un « État de la Nouvelle-Calédonie » inscrit dans la Constitution de la République française, dont l’organisation institutionnelle sera inédite. Que personne ne s’y trompe, pourtant : au-delà des termes employés (qui donneront sans nul doute mal à la tête aux spécialistes du droit constitutionnel), le territoire restera français. La création d’une double nationalité calédonienne et française est également annoncée.
Il y a un an, l’État français a tremblé
Pour ce qui est du statut de la Kanaky, le vrai cœur de cet accord se trouve dans la question du dégel du corps électoral. En Kanaky, seuls étaient autorisés à voter, jusqu’à l’année dernière, les résidents de l’archipel arrivés avant 1998. Ce gel, décidé par les accords de Nouméa, avait permis d’acheter la paix sociale avec les Kanak, qui subissent depuis presque 200 ans la colonisation de leur archipel. Un projet de loi constitutionnel, proposé en 2024 par Darmanin, visait à « dégeler » ce corps électoral. C’est ce projet qui a enflammé la Kanaky, il y a un an : des milliers de bâtiments publics et privés sont pillés, incendiés, des barrages routiers sont établis. Le coût des dégâts est estimé à 2,2 milliards d’euros et plus de 10 % des emplois privés de l’île sont détruits. Toute une partie de l’île Grande Terre (la plus grande des îles de l’archipel) reste inaccessible pendant plusieurs semaines aux représentants de l’État. Les affrontements font 2 morts chez les militaires français, qui tuent 12 Kanak. L’état d’urgence est déclaré par Emmanuel Macron. Le projet de réforme est officiellement abandonné le 1er octobre 2024, mais des responsables kanak sont incarcérés en métropole, à 17 000 km de chez eux, de façon arbitraire pendant plus d’un an. La situation a largement été qualifiée d’« insurrectionnelle », parfois de « guerre civile » : l’État français a tremblé. Depuis, l’économie de l’archipel est en berne et 11 000 colons français ont réémigré en métropole.
Le dégel du corps électoral acté
Les accords de Bougival ont remis sur le tapis cette question brûlante du corps électoral. Et contrairement à tout ce pour quoi se sont battus les Kanak il y a un an, l’une des mesures phares de l’accord est l’ouverture du corps électoral pour les élections provinciales. Concrètement, une fois que le texte sera voté, toutes les personnes nées en Nouvelle-Calédonie ainsi que celles y résidant depuis au moins 15 ans de manière continue pourront voter. « Les Loyalistes et Le Rassemblement se félicitent [de] ce choix », lit-on dans un communiqué commun de ces deux partis réactionnaires.
Pour que l’accord entre en vigueur, et accommoder ce bricolage juridique, il faudra modifier la Constitution française. Pour cela, le texte devra être soumis au vote du Parlement et à l’approbation de la population néo-calédonienne, qui sera consultée par référendum au printemps 2026. Un vote dont les modalités n’ont pas été précisées mais qui n’a pas de quoi inquiéter les Caldoches, ces colons français de l’île : grâce au dégel, leur proportion dans les urnes est quasiment acquise. La réforme permettrait l’ajout d’environ 25 000 électeurs supplémentaires, faisant passer la proportion de Kanak dans les électeurs de 40 % à 35 %. Et, de toutes façons, un tel référendum devra être déclenché par les trois cinquièmes du Congrès (l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie), ce que ne permet pas sa composition actuelle, les indépendantistes disposant d’un peu moins de la moitié des sièges.
Ce ne sont donc pas des urnes que l’État français a peur : trois référendums ont déjà dit non à l’indépendance entre 2018 et 2021 – ce dernier ayant été boycotté par les indépendantistes. Pourtant les Kanak se sont quand même soulevés l’année dernière. Les bulletins de vote pèsent bien peu face aux jets de pierres de la révolte.
Un accord sur le nickel
Pourquoi alors l’État s’acharne-t-il à maintenir la Nouvelle-Calédonie, sous perfusion de financements depuis 1 an pour ne pas sombrer dans la faillite, dans le giron français ? Déjà, l’archipel se situe dans une région stratégique du monde, le Pacifique. L’État français n’a pas du tout envie d’y perdre ce pied-à-terre, d’autant qu’un grand nombre d’unités situées en Polynésie française ont déjà été dissoutes depuis les années 2000. Les bases militaires en Kanaky sont peu nombreuses, mais ce n’est pas une raison pour l’État français de se passer du point d’appui que l’archipel représente dans cette région où les tensions ne vont faire qu’augmenter dans les années à venir.
Le sous-sol kanak en fait également un atout majeur : la Kanaky possède 20 à 30 % des réserves mondiales de nickel, et ne les exploite toujours pas à leur plein potentiel puisqu’elle n’est que le 4e producteur mondial, derrière l’Indonésie, les Philippines et la Russie. Avec l’accord de Bougival, l’État s’est justement engagé, en particulier auprès de l’Union européenne, à « intégrer l’approvisionnement en nickel calédonien dans le cadre de la stratégie de souveraineté en matières premières critiques ». Le nickel représente la première ressource économique du territoire et contribue à une part importante du PIB de la Nouvelle-Calédonie, avec un quart des emplois directs et indirects. Redresser la filière nickel permettrait à la fois de redresser l’économie de l’île et d’approvisionner la France et ses alliés : ce minerai est crucial dans l’industrie lourde et légère, puisqu’il entre dans la composition de l’acier inoxydable et des batteries automobiles.
Le FLNKS sous tension interne
Le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), figure emblématique du mouvement indépendantiste kanak, est le grand signataire de cet accord, après sa validation par un ultime bureau politique. Au début des négociations, pourtant, le député du FLNKS Emmanuel Tjibaou plaidait pour la souveraineté de la Kanaky :« Le peuple kanak n’a jamais abdiqué sa souveraineté et n’y renoncera jamais. » Malaise, donc, de voir le FLNKS signer un accord qui semble vendre la lutte kanak. Un communiqué officiel, publié 2 jours après l’accord, s’en félicite : « Nous, l’équipe mandatée par le FLNKS, avons pris nos responsabilités. »
Le FLNKS, qui fédère de nombreuses composantes, a intégré dans ses rangs, en août 2024, la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), accusée d’être à l’origine des révoltes de mai. Il y a perdu au passage les deux mouvements indépendantistes modérés, le Parti de libération kanak (Palika) et l’Union progressiste en Mélanésie (UPM), gênés par les actions violentes de la CCAT. Le FLNKS a reçu depuis mai 2024 un afflux de jeunes militants kanak.
Pour préparer les échanges à venir, le FLNKS s’est réuni lors d’un congrès en janvier dernier, à Saint-Louis. Les membres ont alors habilité une délégation de représentants à « discuter » aux réunions, mais pas à « négocier » : une nuance qui acte bien que la délégation ne disposait d’aucun mandat pour signer un compromis. Une partie des militants indépendantistes s’étonne de la liberté prise par leurs responsables. « On est sous le choc, dit Marcel Toyon, membre du parti Union calédonienne (UC), principale composante du Front. On a répété qu’ils ne devaient rien signer. »
Quelques jours plus tard, la Commission exécutive de l’UC publie un communiqué qui dénonce l’accord : « Les fondamentaux du combat du peuple kanak n’y apparaissent pas. » Sur le compte twitter de la Commission politique et citoyenneté du FLNKS, on peut lire, le 21 juillet : « Bougival n’est plus. » À noter que Christian Tein, président du FLNKS depuis août 2024 et leader de la CCAT ayant passé presque 1 an derrière les barreaux des prisons françaises, n’était pas convié aux négociations.
Malgré les efforts de la presse bourgeoise pour faire croire que cet accord historique est accueilli très favorablement de tous les côtés, tout indique qu’il est loin de faire l’unanimité ne serait-ce qu’au sein du FLNKS. Et rien ne laisse présager que les Kanak, des jeunes aux moins jeunes, accepteront sans broncher de laisser leur île se faire davantage dépecer par la bourgeoisie impérialiste.
Le prix du sang
Le peuple kanak a, en effet, une longue histoire de révolte au sein de l’impérialisme français. Entre les années 1970 et 1990, il s’est violemment soulevé, rejetant la voix électorale et prenant les armes lors de la prise d’otages d’Ouvéa. Les Kanak ont, en 1988, payé le prix du sang : 19 d’entre eux sont tombés, emportant au passage 2 militaires français venus les assassiner. Les Kanak, en payant avec courage ce prix du sang, ont forcé la France impérialiste à la table des négociations entre 1988 et 1998.
36 ans plus tard, 12 Kanak ont été tués par les forces militaires françaises lors des révoltes de 2024. Aucun journal, aucun politicien n’a jamais évoqué ce scandale, car la vérité est bien simple : les Kanak ne sont pas considérés comme des citoyens français. Jamais 12 Français de métropole n’auraient pu être tués dans une telle indifférence.
La vérité, la seule vérité qui mérite d’être martelée, est la suivante : si l’État français a accepté de s’asseoir à la table des négociations, par la présence de Manuel Valls, c’est uniquement parce que de courageux Kanak se sont soulevés, cocktails molotov à la main, il y a un an. Seule la violence révolutionnaire dont ils ont fait preuve a pu forcer la main de l’État impérialiste français, qui opprime la Kanaky depuis presque 200 ans ; et seule la violence révolutionnaire, à nouveau, leur permettra de s’en libérer.